En 2025, la France, deuxième plus grand territoire maritime au monde, célèbre l'Année de la Mer, une initiative nationale visant à éveiller les consciences face à l'urgence de protéger l'Océan.
C'est le thème que j'ai choisi de développer pour illustrer mes cartes de voeux.
L'orque de 1935 à nos jours
L’Antarctique, les eaux norvégiennes (dans l’Atlantique nord) et celles du Japon (dans le Pacifique nord), sont, au XXe siècle, les principales zones de chasse à l’orque. Entre 1935 et 1980, 6000 individus ont ainsi été capturés.
Cette chasse à petite échelle, qui profitait surtout aux populations humaines habitant dans ces régions, a été pratiquée non pas tant pour la chair de l’animal (impropre à la consommation humaine et qui était transformée en aliments pour animaux) que pour l’huile qu’il peut fournir (environ 700 kg pour un adulte) et pour sa peau.
Le derme, très épais, qui renferme un solide réseau de collagène, était employé pour la fabrication de semelles de chaussures !
Dans les années 70, le rythme de chasse à l’orque devenait un danger pour les populations mondiales d’orques ; des directives furent adoptées dans certains pays pour réduire cette destruction (en 1970 arrêté en France, au Canada...).
Au niveau mondial, c’est la Commission Baleinière Internationale qui régit les prélèvements. Elle a fait valoir que l’on ne connaissait pas l’importance exacte des populations exploitées, notamment dans l’Atlantique et, à sa demande, la chasse a été interdite en 1981.
Mais les industries de l’huile ou de chaussures n’ ont pas été les seules causes de la chasse à l’orque. Les orques ont été et sont encore la proie des baleiniers; la chasse réelle à l’orque débuta dans les années 50, en Norvège, au Danemark, Japon, ex URSS, Canada, USA , Pérou, Afrique du Sud… Les pêcheurs japonais, islandais et norvégiens notamment, inquiets des prélèvements par l’épaulard sur leurs stocks de poissons (saumons et harengs principalement) et des dommages qu’il causait aux engins de pêche on fait pression pour réduire ses effectifs.
En Islande, les orques ont appris à récupérer les flétans pris aux hameçons sans même abîmer les lignes : elles prennent le corps du poisson et laissent la tête accrochée à l’hameçon (Bloch et al., 1988).
Dans le Pacifique du Nord-Est, on a estimé que les poissons prélevés par les orques ne représentaient que 7 % environ de la totalité des produits pêchés, ce qui est fort modeste. En revanche, au large des côtes norvégiennes, certaines évaluations chiffrent à 48 000 tonnes la consommation annuelle de harengs par les orques, ce qui représente un pourcentage très élevé du stock de frai de ce poisson. Il est pourtant des cas où les orques coopèrent malgré elles avec les pêcheurs, elles indiquent de leur présence les bancs de poissons (Tasmanie, îles Féroé).
Peu à peu à la chasse s’est substituée la capture d’animaux vivants destinés aux aquariums (Olesiuk et al.,1990). La première orque capturée le fut en Californie, en 1961, une petite femelle dans le port de Newport. Elle fut remorquée dans des filets et transportée au Marineland du Pacifique (Sud de Los Angeles). Affolée elle se jeta violemment contre les parois du bassin et mourut le jour même.
Le Marineland tenta une nouvelle capture, au large de Puget Sound l’année suivante: ils capturèrent une femelle mais les cordages furent pris dans l’hélice du bateau. La femelle appela si fort qu’une orque mâle attaqua le bateau ; les marins se virent menacés et ils les tuèrent tous les deux. Cet échec découragea une nouvelle tentative de la part du Marineland.
Prélevées jusqu’en 1976 dans le détroit de Puget en Colombie Britannique, elles ont été capturées ensuite dans les eaux islandaises (c’est le cas de Kim, Freya et Sharkane au Marineland d’Antibes) et ce jusqu’en 1988. Depuis, il n’y a plus de capture, les orques se reproduisent en captivité.
Les populations sauvages aujourd’hui mieux aimées et mieux connues de l’homme paraissent très florissantes.
Cependant ce nouvel intérêt et cette popularité auprès du grand public constituent paradoxalement une menace pour ces animaux. Une véritable industrie touristique (« whale watching ») s’est développée à leurs dépens. Dans certaines zones d’Amérique du Nord, leur domaine est maintenant sillonné par de nombreux bateaux qui, souvent, portent atteint à leur tranquillité. Dans le détroit de Puget en particulier, le trafic maritime a considérablement augmenté et l’habitat de l’orque subit de ce fait des nuisances acoustiques croissantes. Or,l’audition, est le sens dominant chez les Cétacés.
Des troubles peuvent alors apparaître chez l’orque, et altérer grandement les capacités de survie et le comportement social. Le trafic maritime et les bruits qu’il engendre constituent donc une sérieuse menace dont il importe d’évaluer les nuisances par un suivi de la population.
Par ailleurs une pollution chimique notable affecte cette même région. Les poissons concentrent de nombreux produits chimiques toxiques, tels le mercure, le plomb, l’arsenic…
Source: extrait d'un article du site https://www.orques.fr/index.php?page=biologie-milieunaturel










_-_2021-08-01_-_2.jpg)









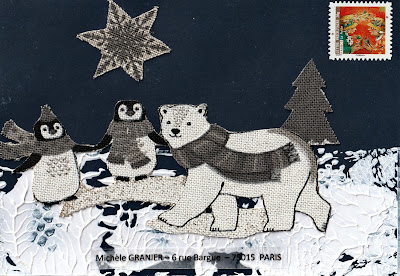























.jpg)

